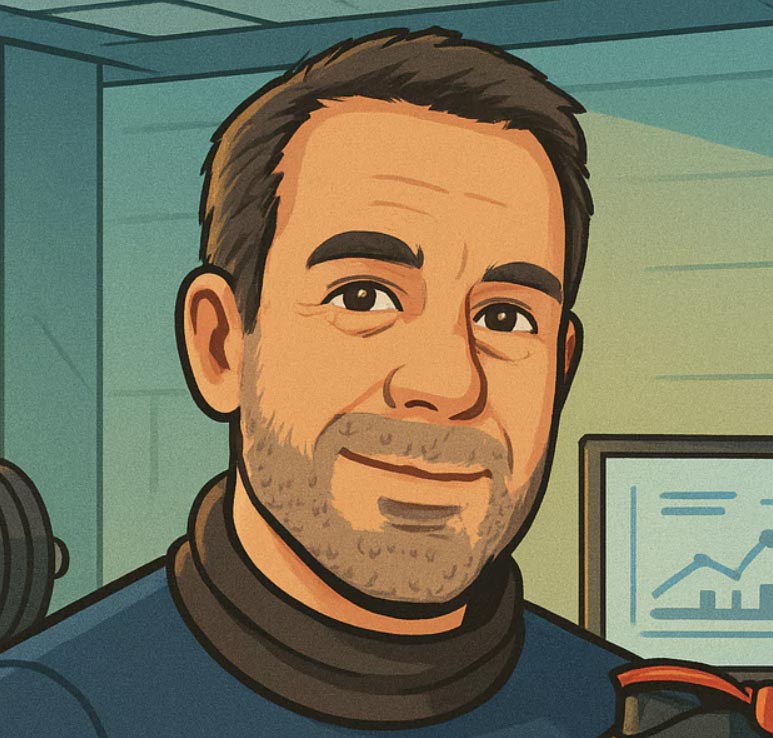Table des matières
ToggleIntroduction
La musculation est une discipline exigeante où la nutrition joue un rôle aussi déterminant que l’entraînement. Pourtant, de nombreux pratiquants commettent des erreurs qui entravent leur progression et nuisent à leur santé. Certaines de ces pratiques sont héritées d’anecdotes transmises dans les salles de sport, tandis que d’autres proviennent d’interprétations erronées de la littérature scientifique. Pour comprendre ces erreurs et les corriger, il est nécessaire de se baser sur des études sérieuses. Ce dossier propose un panorama des erreurs nutritionnelles les plus courantes en musculation et apporte des conseils pratiques appuyés par des publications scientifiques.
1. L’hyperprotéinisation : quand trop n’est pas mieux
1.1 La consommation de protéines chez les bodybuilders
La culture de la musculation valorise une consommation élevée de protéines. Cette tendance est confirmée par les études : une enquête réalisée auprès de 35 pratiquants amateurs a montré que leur apport quotidien atteignait en moyenne 1,8 g/kg de poids corporel, avec des valeurs allant de 0,9 à 3,7 g/kg. Plus de 31 % de ces apports provenaient de compléments alimentaires, ce qui témoigne d’un recours massif aux suppléments protéinés.
Les recommandations du JISSN pour optimiser la synthèse protéique musculaire (MPS) se situent entre 1,6 et 2,2 g/kg/jour, répartis en plusieurs prises (0,40–0,55 g/kg/repas). Une consommation plus élevée n’apporte pas de bénéfice supplémentaire, tandis qu’une dose trop basse (<1,25 g/kg/jour) risque d’être insuffisante pour la réparation tissulaire.
1.2 Les risques d’un excès de protéines
Des apports extrêmement élevés peuvent avoir des effets inattendus. Une méta‑analyse récente a montré que les régimes très riches en protéines (>3,4 g/kg/jour) diminuaient la testostérone totale d’environ 5,23 nmol/L chez les hommes. L’auteur note que les régimes modérément riches (1,9–3,4 g/kg/jour) ne provoquent pas cette baisse hormonale, ce qui suggère un plafond au‑delà duquel l’excès protéique devient contre‑productif. Le même article précise que la capacité de synthèse de l’urée (MRUS) est limitée ; au‑delà de 3,35 g/kg/jour, l’organisme pourrait accumuler de l’ammoniac ou présenter des troubles digestifs (diarrhée, retard de vidange gastrique). Dans un essai de 8 semaines avec un apport de 4,4 g/kg/jour, 10 participants sur 30 ont abandonné l’étude et plusieurs ont signalé une gêne digestive ou une sensation de chaleur.
1.3 Optimiser ses apports
La littérature recommande de se limiter à 1,6–2,2 g/kg/jour pendant l’intersaison, avec un fractionnement en 3 à 6 repas. L’ingestion de 20–40 g de protéines toutes les 3–4 heures optimise la MPS. Des protéines complètes, comme celles des produits laitiers, de la viande maigre, du poisson ou des alternatives végétales riches en acides aminés essentiels, doivent constituer la base de l’alimentation. Les compléments protéiques peuvent aider à atteindre l’apport recommandé mais ne doivent pas remplacer les aliments entiers. Voici un lien utile pour choisir une bonne whey isolate.
2. Sous‑consommation de glucides : la crainte injustifiée du sucre
2.1 Le rôle des glucides dans la performance
Les glucides constituent la principale source d’énergie lors des séances de musculation. Les recommandations générales pour les bodybuilders en phase d’entraînement préconisent un apport de 55–60 % de l’énergie sous forme de glucides. L’ACSM souligne qu’un apport suffisant en glucides et en protéines est essentiel pour reconstituer les réserves de glycogène, maintenir la masse maigre et optimiser la performance.
Pour des entraînements intenses ou des compétitions de longue durée, le JISSN recommande une consommation de 8 à 12 g/kg/jour de glucides pour saturer les réserves de glycogène. Après l’effort, un apport de 1,2 g/kg/h de glucides à index glycémique élevé, associé à 0,2–0,4 g/kg/h de protéines, accélère la resynthèse du glycogène.
2.2 Erreurs courantes
De nombreux bodybuilders réduisent drastiquement les glucides pour favoriser la définition musculaire. Or, une revue systématique des apports nutritionnels a montré que la plupart des compétiteurs consomment moins de 6 g/kg/jour de glucides et moins de 30 % des calories totales sous forme de lipides, mais des quantités de protéines très élevées (jusqu’à 4,3 g/kg/jour). Ce déséquilibre peut réduire les réserves de glycogène, provoquer une fatigue prématurée et entraîner un catabolisme musculaire malgré des apports protéiques élevés.
Une inquiétude fréquente concerne la prise de masse grasse lorsque les glucides sont augmentés. Toutefois, la recherche montre qu’une alimentation légèrement hypercalorique (10–20 % au‑dessus de l’entretien) combinée à un apport glucidique adéquat (≥3–5 g/kg/jour) permet d’augmenter lentement la masse musculaire sans accumulation excessive de graisse. Pour la préparation à une compétition, une restriction calorique d’environ 15 % et un apport en glucides suffisant sont recommandés afin de préserver la masse maigre tout en réduisant la masse grasse.
2.3 Conseils pratiques
Les glucides à digestion lente (avoine, riz complet, patates douces, fruits) doivent constituer l’essentiel de l’alimentation hors entraînement. Les glucides rapides (bananes, dattes) sont particulièrement utiles avant et après l’entraînement. Boire une solution glucidique (30–60 g/h) pendant les séances prolongées (>60 minutes) peut maintenir la glycémie et améliorer l’endurance. L’objectif est de maintenir des réserves de glycogène suffisantes pour des performances optimales et une récupération rapide.
3. La peur des lipides et la baisse des hormones
3.1 Lipides et hormones sexuelles
Une erreur fréquente consiste à réduire fortement l’apport en lipides pour améliorer la définition musculaire. Pourtant, les lipides jouent un rôle majeur dans la production d’hormones stéroïdiennes (testostérone, œstrogènes), l’absorption des vitamines liposolubles et la santé cellulaire. Une méta‑analyse comparant régimes à haute teneur en lipides et régimes pauvres en lipides a révélé que les régimes très pauvres en lipides (environ 14 % des calories totales) entraînaient une diminution significative de la testostérone totale, libre et de la dihydrotestostérone. Même si les travaux disponibles portent essentiellement sur des hommes, ils suggèrent qu’une réduction excessive des lipides peut nuire à l’équilibre hormonal.
3.2 Recommandations pour les lipides
Le ratio recommandé pour les bodybuilders est de 15–30 % de l’apport énergétique sous forme de lipides. Dans l’intersaison, la consommation peut être légèrement supérieure (0,5–1,5 g/kg/jour) afin de soutenir la production hormonale et fournir suffisamment de calories. Les sources riches en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés (avocat, huile d’olive, noix, poissons gras) doivent être privilégiées au détriment des graisses saturées. Un apport adéquat en oméga‑3 favorise une meilleure sensibilité à l’insuline et réduit l’inflammation.
3.3 Limites des régimes trop pauvres en lipides
Outre leur effet potentiel sur la testostérone, les régimes très faibles en lipides (<15 % de l’énergie) peuvent entraîner une carence en vitamines A, D, E et K, qui sont liposolubles. Ces vitamines sont impliquées dans la vision, la croissance osseuse, l’immunité et la coagulation. Les carences s’observent rarement dans les populations occidentales mais peuvent apparaître chez les athlètes restrictifs, notamment lors de périodes de définition extrême. Il est donc essentiel de maintenir un apport lipidique suffisant tout en contrôlant l’apport calorique total.
4. Régimes hypocaloriques extrêmes et perte musculaire
Les compétiteurs ont tendance à réduire drastiquement les calories pour perdre rapidement de la graisse. Cependant, une perte de poids trop rapide (>1 % du poids corporel par semaine) favorise la perte de masse musculaire et de performance. La littérature suggère de viser une perte de 0,5–1 % par semaine pour maximiser la rétention de masse maigre. Les apports en protéines devraient être augmentés (2,3–3,1 g/kg de masse maigre) et les glucides ajustés pour soutenir l’entraînement.
Les régimes hypocaloriques prolongés réduisent également le taux métabolique de repos, augmentent la faim et peuvent favoriser des comportements alimentaires compulsifs. Pour éviter ces effets, il est conseillé d’intégrer des pauses caloriques (refeeds) où l’apport énergétique est temporairement augmenté, principalement via des glucides. Cela permet de reconstituer les réserves de glycogène, de stimuler la leptine (hormone de satiété) et de soutenir les performances sans nuire à la perte de graisse.
5. Mauvaise compréhension du nutrient timing
5.1 Avant, pendant et après l’entraînement
Le nutrient timing se réfère au moment d’ingestion des nutriments par rapport à l’entraînement. Le JISSN recommande de consommer des glucides et des protéines avant et après les séances pour optimiser la synthèse des protéines musculaires et la récupération. Prendre environ 20–40 g de protéines complètes toutes les 3–4 heures stimule la MPS (synthèse des protéines musculaires). De plus, une collation post‑entraînement contenant 1,2 g/kg/h de glucides et 0,2–0,4 g/kg/h de protéines favorise la resynthèse du glycogène.
Pour les séances de musculation de moins d’une heure, les bénéfices d’une nutrition intra‑entraînement sont limités. Cependant, lors d’entraînements plus longs ou de sessions combinées (musculation + cardio), la consommation de 30–60 g/h de glucides dans une boisson électrolytique peut maintenir la glycémie et retarder la fatigue.
5.2 Fréquence des repas
Beaucoup de bodybuilders consomment 6 à 8 repas par jour en pensant qu’une fréquence élevée augmente la dépense énergétique ou accélère le métabolisme. Cependant, les études montrent que la fréquence des repas a peu d’effet sur la perte de masse grasse ou la composition corporelle lorsqu’elle est contrôlée pour l’apport calorique total et la répartition des macronutriments. L’essentiel est de répartir les protéines de manière équitable sur la journée et de s’assurer d’avoir des collations pré et post‑entraînement pour favoriser la récupération.
6. Déshydratation et manipulation de l’eau : l’équilibre fragile
6.1 Pourquoi l’hydratation est cruciale
L’eau représente 50–70 % de la masse corporelle et se répartit entre les compartiments intracellulaire (65 %) et extracellulaire (35 %). Pendant l’exercice, la transpiration entraîne une perte d’eau et d’électrolytes. Une déshydratation (>2–3 % de la masse corporelle) augmente la perception de l’effort, diminue l’endurance et expose à un risque de coup de chaleur. Les sensations de soif ne reflètent pas toujours l’état d’hydratation pendant l’effort ; il est donc important de planifier l’hydratation.
6.2 Directives d’hydratation
Les recommandations générales comprennent : (1) commencer l’entraînement en étant bien hydraté, (2) prévenir une déshydratation excessive en buvant régulièrement durant l’exercice, et (3) reconstituer les pertes de fluides après l’effort. Il est conseillé d’éviter des pertes de poids supérieures à 2–3 % pendant une séance. Les besoins en fluides varient selon la durée, l’intensité, la température ambiante et la sudation individuelle. Pour estimer le volume à boire, on peut se peser avant et après l’entraînement ; chaque kilogramme perdu correspond à environ un litre d’eau à remplacer..
Une surveillance quotidienne de la couleur de l’urine et de la sensation de soif au réveil permet d’évaluer l’hydratation. Une urine foncée et une forte sensation de soif indiquent souvent un apport insuffisant en eau. Enfin, un excès de boisson peut entraîner une hyponatrémie (dilution du sodium sanguin), surtout lors d’épreuves d’endurance où les athlètes boivent de grandes quantités d’eau sans électrolytes.
6.3 Manipulations avant la compétition
Les pratiquants de bodybuilding utilisent souvent des stratégies de « peak week » consistant à manipuler l’eau, le sodium et les glucides pour améliorer l’apparence. Une étude portant sur 81 compétiteurs naturels a montré que 93,8 % modifiaient leur alimentation la semaine précédant la compétition, notamment via des chargements et décharges en glucides, une surconsommation ou restriction hydrique et sodique, voire une utilisation excessive de vitamine C comme diurétique. La littérature indique que la déshydratation peut donner un aspect « plat » aux muscles et nuire à la performance ; l’eau est nécessaire pour maintenir le volume musculaire. Les manipulations extrêmes peuvent entraîner des déséquilibres électrolytiques et des effets secondaires graves (vertiges, crampes, troubles cardiaques).
Les compétiteurs doivent donc limiter ces pratiques et tester toute stratégie plusieurs semaines auparavant pour évaluer ses effets. Boire suffisamment d’eau tout en modulant l’apport en glucides (carboloading) peut suffire à augmenter temporairement le volume musculaire sans mettre en danger la santé.
7. Carences en micronutriments et impact sur la performance
7.1 Vitamine D : un problème répandu
Une revue systématique récente sur les micronutriments et la performance sportive a relevé que plus de 50 % des athlètes présentaient une insuffisance en vitamine D, certains travaux rapportant même des taux de déficience de 70–90 %. Les facteurs de risque incluent l’entraînement en intérieur, la pigmentation cutanée foncée et la vie en altitude. La vitamine D contribue à la synthèse de diverses hormones et joue un rôle dans la force et la puissance musculaires. Des essais contrôlés ont montré qu’une supplémentation hebdomadaire de 50 000 UI pendant huit semaines augmentait les niveaux de 25‑hydroxyvitamine D d’environ 17 ng/mL et améliorait les performances de sprint et de force chez des athlètes déficients. Toutefois, une étude chez des nageurs adolescents n’a pas retrouvé de différence de performance entre un groupe supplémenté (2000 UI/jour) et un groupe placebo, ce qui suggère que l’effet de la supplémentation dépend probablement du statut initial en vitamine D et du type d’effort.
7.2 Fer, zinc et autres minéraux
Le fer est nécessaire au transport de l’oxygène et à la production d’énergie dans les mitochondries. Une carence, même sans anémie, altère la fonction musculaire et réduit la capacité d’endurance. Les athlètes d’endurance et les femmes sont particulièrement à risque en raison des pertes menstruelles et des microtraumatismes. Le zinc participe à la synthèse des protéines et à la production d’énergie ; une déficience réduit l’endurance et augmente le risque d’ostéoporose. Le magnésium joue un rôle clé dans la contraction musculaire et la production d’ATP ; une déficience peut favoriser l’hypertension et l’inflammation.
Malgré la popularité des multivitamines, les suppléments ne sont généralement nécessaires que lorsqu’une déficience est confirmée par un professionnel de santé. Une revue du JISSN signale que la plupart des apports en micronutriments peuvent être couverts par une alimentation équilibrée et que la supplémentation devrait être individualisée.
7.3 Conséquences de l’excès et du déficit
Un déficit prolongé en micronutriments peut se traduire par une baisse de la performance, une fatigue chronique et un risque accru de blessures. À l’inverse, la prise excessive de certains micronutriments (notamment les vitamines liposolubles) peut entraîner des effets toxiques. Des cas d’hypervitaminose D ou d’hypercalcémie ont été rapportés chez des sportifs consommant des doses très élevées de suppléments sans contrôle médical. Il est donc essentiel de réaliser un bilan sanguin régulier et de consulter un professionnel de santé pour ajuster son apport.
8. Régimes pauvres en fibres et santé intestinale
Les régimes de musculation sont souvent pauvres en fibres pour éviter les ballonnements. Cependant, les fibres alimentaires nourrissent le microbiote et contribuent à la santé digestive. Une étude observationnelle comparant des bodybuilders, des coureurs de fond et des sujets sédentaires a montré que les bodybuilders suivaient une alimentation riche en protéines et en graisses, mais faible en glucides et en fibres. Cette alimentation déséquilibrée était associée à une moindre abondance de bactéries bénéfiques (Bifidobacterium, Lactobacillus, productrices d’acides gras à chaîne courte) et à une augmentation de bactéries opportunistes. Chez les coureurs, un apport élevé en protéines était corrélé à une diminution de la diversité microbienne (indices d’alpha‑diversité).
La même étude souligne que les régimes riches en protéines et pauvres en fibres favorisent la fermentation putréfactive dans le côlon, produisant de l’ammoniac, des phénols et des indoles, qui peuvent endommager l’ADN des cellules du côlon. De plus, une faible consommation de fibres ralentit le transit intestinal et réduit la fréquence des selles, ce qui peut engendrer des troubles digestifs.
Conseils pour l’apport en fibres
Le consommateur doit viser 25–30 g de fibres par jour, en privilégiant les fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes. Les fibres solubles (avoine, légumineuses) améliorent la sensibilité à l’insuline et la santé cardiovasculaire, tandis que les fibres insolubles (blé complet, légumes) favorisent le transit. Il est judicieux de réduire légèrement l’apport en fibres les jours précédant une compétition pour éviter les inconforts gastro‑intestinaux, mais il est déconseillé de l’éliminer complètement.
9. Excès de compléments alimentaires et recours aux substances dangereuses
La consommation de compléments est très répandue dans le milieu de la musculation. L’étude mentionnée plus haut rapportait que 31 % de l’apport protéique provenait des compléments. Les macro‑compléments (poudres de protéines, gainers) sont souvent utilisés sans vérifier l’adéquation du régime alimentaire global. Certains compétiteurs recourent également à des compléments plus controversés (brûleurs de graisse, pré‑workouts très dosés en stimulants).
Si certains suppléments ont fait la preuve de leur efficacité – créatine monohydrate, caféine, bêta‑alanine – d’autres ne présentent pas de bénéfice démontré. Le JISSN recommande d’utiliser uniquement les compléments dont l’efficacité et la sécurité sont établies et d’éviter l’automédication. La législation européenne interdit d’ailleurs la vente de nombreux stimulants et prohormones, mais ceux‑ci restent accessibles sur Internet et exposent à des risques cardiovasculaires, hépatiques et hormonaux.
En période de définition, certains pratiquants utilisent des diurétiques ou des laxatifs pour réduire le poids d’eau. Ces substances peuvent entraîner une déshydratation sévère, des troubles électrolytiques et des dommages rénaux. Les stratégies de pertes de poids rapides devraient être encadrées par un professionnel de santé afin d’éviter des conséquences graves.
10. Problèmes psychologiques et troubles du comportement alimentaire
La culture de la musculation met l’accent sur l’esthétique et la discipline, ce qui peut mener à des comportements extrêmes. L’obsession de la composition corporelle est associée à un risque accru de troubles du comportement alimentaire (TCA) chez les pratiquants. Un article de la JISSN note que les compétiteurs doivent être attentifs au développement de troubles alimentaires et qu’ils bénéficieraient d’un soutien psychologique. Les régimes yo‑yo et les restrictions sévères peuvent déclencher des épisodes d’hyperphagie suivis de compensation (vomissements, utilisation de laxatifs) qui nuisent à la santé physique et mentale.
Pour prévenir ces dérives, il est essentiel de privilégier une approche flexible, d’accepter des fluctuations de poids raisonnables et de ne pas se comparer constamment aux standards irréalistes véhiculés par les réseaux sociaux. La consultation régulière d’un diététicien et, au besoin, d’un psychologue du sport peut aider à maintenir un rapport sain à l’alimentation et à son corps.
11. Conseils pratiques et synthèse
11.1 Résumé des erreurs courantes
| Erreur nutritionnelle | Conséquences potentielles | Correctifs recommandés |
| Consommation excessive de protéines (>3,4 g/kg/jour) | Baisse de la testostérone, surcharge rénale et hépatique, troubles digestifs | Viser 1,6–2,2 g/kg/jour, privilégier les sources complètes, répartir sur 3–6 repas |
| Sous‑consommation de glucides | Diminution des réserves de glycogène, fatigue, catabolisme musculaire | Consommer 3–5 g/kg/jour hors compétition et jusqu’à 8–12 g/kg/jour en phase de recharge |
| Régimes pauvres en lipides (<15 % des calories) | Diminution de la testostérone, carence en vitamines liposolubles, baisse de la récupération | Maintenir 15–30 % de lipides, privilégier les acides gras mono et polyinsaturés |
| Déshydratation ou manipulation extrême de l’eau | Baisse de performance, risque de coup de chaleur, déséquilibres électrolytiques | S’hydrater avant, pendant et après l’effort ; éviter les pertes de plus de 2–3 % du poids corporel |
| Carences en micronutriments (vitamine D, fer, magnésium, zinc) | Baisse de la force, fatigue, fractures, anémie | Suivre un régime varié, contrôler régulièrement son statut, consulter un professionnel avant de se supplémenter |
| Régimes pauvres en fibres | Dysbiose, baisse des bactéries bénéfiques, production de composés toxiques | Viser 25–30 g/jour de fibres issues de fruits, légumes et céréales complètes, réduire légèrement avant compétition |
| Recours excessif aux compléments | Intoxications, effets secondaires, surcharge hormonale ou stimulante | Utiliser des compléments ayant prouvé leur efficacité (créatine, caféine, bêta‑alanine) et respecter les dosages |
| Régimes hypocaloriques extrêmes | Perte de masse musculaire, baisse du métabolisme, troubles hormonaux | Visée de 0,5–1 % de perte de poids/semaine, intégration de refeeds, maintien d’apports suffisants en protéines et glucides |
| Obsessions esthétiques et TCA | Anxiété, hyperphagie, boulimie, risque de dépression | Approche flexible, soutien psychologique, acceptation de fluctuations de poids et objectif santé |
11.2 Bonnes pratiques générales
- Personnaliser l’alimentation : chaque athlète a des besoins spécifiques selon son poids, sa composition corporelle, son sexe, son niveau d’entraînement et ses objectifs. Un suivi par un diététicien ou un nutritionniste du sport permet d’ajuster les apports et de détecter les carences.
- Privilégier les aliments entiers : ils apportent, en plus des macronutriments, des vitamines, minéraux, fibres et antioxydants nécessaires à la santé. Les compléments doivent rester un ajout et non la base du régime.
- Périodiser la nutrition : distinguer l’intersaison (légère hypercalorie, progression lente de la masse musculaire) de la phase pré‑compétition (déficit modéré, maintien de la masse maigre). Adapter les apports en conséquence.
- Rester à l’écoute de son corps : fatigue chronique, troubles digestifs, baisse de libido ou irritabilité peuvent signaler une déficience ou un excès. Des analyses sanguines régulières permettent d’ajuster la stratégie.
- Planifier les périodes de repos et la récupération : le sommeil, la gestion du stress et la récupération active sont tout aussi importants que l’entraînement et la nutrition pour favoriser les adaptations et prévenir les blessures.
Conclusion
La musculation nécessite discipline et rigueur, mais pas de sacrifices extrêmes. Les erreurs nutritionnelles telles que l’hyperprotéinisation, la restriction excessive des glucides et des lipides, la déshydratation volontaire, l’abus de compléments ou la suppression des fibres peuvent freiner la progression et nuire à la santé. Les données issues des revues scientifiques (PubMed, JISSN, ACSM, Nature, etc.) montrent l’importance de respecter des principes basés sur la physiologie : ajuster l’apport énergétique selon les phases d’entraînement, consommer suffisamment de glucides et de lipides pour soutenir la performance et l’équilibre hormonal, viser une consommation modérée de protéines, maintenir une bonne hydratation et assurer un apport adéquat en micronutriments et en fibres. En adoptant une approche globale et individualisée, les pratiquants de musculation peuvent optimiser leurs résultats tout en préservant leur santé à long terme.
Sources
Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ. Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2014. DOI: 10.1186/1550-2783-11-20.
Helms ER, Aragon AA, Schoenfeld BJ. Nutrition Recommendations for Bodybuilders in the Off-Season: A Narrative Review. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2019. PMC6680710.
Jäger R, et al. International society of sports nutrition position stand: protein and exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2017. PubMed PMID: 28642676.
Kerksick CM, et al. International society of sports nutrition position stand: nutrient timing. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2017. PubMed PMID: 28919842.
Rodriguez NR, Di Marco NM, Langley S. American College of Sports Medicine position stand. Nutrition and athletic performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2009. PubMed PMID: 19225360.
Slater G, Phillips SM. Macronutrient considerations for the sport of bodybuilding. Sports Medicine, 2003. PubMed PMID: 15107010.
Tinsley GM, et al. Nutritional Peak Week and Competition Day Strategies of Competitive Natural Bodybuilders. Sports (Basel), 2018. PMC6315482.
Chappell AJ, et al. Dietary Intake of Competitive Bodybuilders. Sports Medicine – Open, 2015. PubMed PMID: 25926019.
Dankel SJ, et al. High-protein diets and testosterone. Nutrients, 2023. PMC10114259.
Fanton Y, et al. The combination of sport and sport-specific diet is associated with characteristics of gut microbiota: an observational study. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2019. DOI: 10.1186/s12970-019-0290-y.
Peeling P, et al. Practical Hydration Solutions for Sports. Nutrients, 2019. PMC6682880.
Maughan RJ, et al. Exploring the Relationship between Micronutrients and Athletic Performance: A Systematic Review. Sports Medicine, 2023. PMC10302780.
Morton RW, et al. Evaluation of Protein Content in the Diet of Amateur Male Bodybuilders. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020. PubMed PMID: 33256520.
Hackney AC, et al. Low-fat diets and testosterone in men: systematic review and meta-analysis of intervention studies. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2021. PubMed PMID: 33540147.